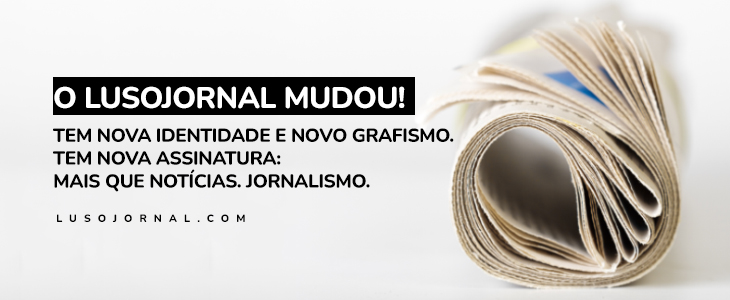
«Lisbonne est un éventail qui s’ouvre et se ferme», phrase de Jean Giraudoux que Patrick Straumann cite dans son livre «Lisbonne ville ouverte» dans lequel il nous décrit la Lisboa des années 1940, années de guerre en Europe. Straumann, de son côté, écrit sur Lisboa de ces années de conflit : «la dernière porte vers la liberté pour une Europe qui sombrait dans la nuit totalitaire. Et cette Europe n’a jamais retrouvé la pleine lumière».
Nous partons à la découverte de Jean Giraudoux… nous apprenons que ce dernier partira, lui aussi, à la quête, en quête au Portugal, de son fils, en 1940, quand l’Europe était en guerre, la II Guerre mondiale. Il écrira même une partie d’un de ses livres sur ce voyage, sur cette quête.
Nous partageons ici nos découvertes sur Jean Giraudoux qui s’est trouvé au Portugal, à une autre occasion, pendant la I Guerre mondiale.
.
Hippolyte Jean Giraudoux est né le 29 octobre 1882 et a été mobilisé comme sergent en 1914, puis nommé sous-lieutenant. Il s’est blessé le 16 septembre 1915, dans l’Aisne (au nord-est de Vingré), lors de la contre-offensive qui a suivi la victoire de la Marne, aux Dardanelles. Convalescent, il rentre au Bureau de la Propagande du Ministère des affaires étrangères, avant de participer à une mission militaire et diplomatique au Portugal, entre août et novembre 1916. Le Portugal s’activait alors à former le contingent du Corps Expéditionnaire Portugais (CEP), l’Allemagne lui ayant déclaré la guerre en mars 1916. Avant le Miracle de Fátima, un autre, selon des journalistes de l’époque, aura lieu à Tancos, lieu de formation à la guerre ultra-rapidement.
Jean Giraudoux s’ennuie au bureau, il perd du poids et à la fin de la première semaine d’août il apprend le résultat de sa démarche auprès de l’ami Berthelot. Il sera attaché à une Mission militaire anglo-française que les deux Gouvernements envoient à Lisboa.
Le 22 août, les journaux, sous le titre «La coopération portugaise», publient les noms des membres de la Mission. Le lendemain, le 23 août, Paul Morand, rentré à Paris, titre dans son journal : «Berthelot a fait nommer Giraudoux à la Mission anglo-française chargée d’instruire les troupes portugaises. Giraudoux part pour Lisbonne».
Le départ a lieu le lundi 28 août, à 18h05. Le train prendra deux jours et deux nuits pour atteindre sa destination. Le 30 au matin, la mission est reçue à la frontière par deux officiers portugais qui les escortent jusqu’à Lisboa. À la gare de Rossio, ils sont accueillis par les Secrétaires des Délégations française et britannique et par des représentants du Gouvernement. Ils s’installent à l’hôtel Avenida Palace et, dans la soirée, ils ont trois réceptions : à la Légation de France, à la Présidence du Conseil, et enfin au Ministère des affaires étrangères. Un officier, le Capitaine Matias de Castro, est mis en permanence à la disposition des membres de la mission.
L’hebdomadaire «Ilustração Portugueza» du 11 septembre 1916 donnait l’information, avec une photo dans laquelle on voit le lieutenant-colonel Paris, le commandant Grandin et le sous-lieutenant Giraudoux. Le commentaire était le suivant : «La mission militaire anglo-française a eu le plus chaleureux accueil. La Commission est venue dans notre pays pour des concertations, le sujet étant en rapport avec la coopération de l’Armée portugaise à côté des Alliés dans les champs de bataille. En leur honneur, des banquets et autres fêtes ont eu lieu, elles se sont passées dans le plus grand des enthousiasmes avec des échanges de cadeaux qui confirment les bonnes relations entre le Portugal et les Alliés».
En tout, Jean Giraudoux passe deux mois et demi au Portugal, d’où il envoie trente-deux lettres à Suzanne Boland, son épouse. De la consultation de cet abondant courrier, nous retirons de précieux enseignements.
Le 1er septembreil écrit : «Il faut huit jours pour que les lettres habituelles arrivent à Lisboa ; elles sont soumises à trois censures. Je t’enverrai les miennes par les courriers qui partent de la Légation les mercredis et les samedis, Paul te les fera suivre aussitôt… Mon petit Suzon chéri, me voici bien seul avec mes cinq compagnons et mes cent mille Portugais… lit que me paye le Gouvernement portugais dans une chambre de six mètres de haut, avec, pour mur du côté de la rue, une immense croisée ogivale dont on tire le soir les rideaux grenat. Il faut deux hommes pour les manœuvrer. C’est une chambre de Brésilien en vacances, toute rose, avec des portes blanc-glacé et un tapis rouge avec des couronnes blanches. Le lit est plus grand que toutes les espèces de lit jusque-là reconnues… dans les journaux, des photographies où nous ressemblons aux apaches les plus réputés, et où j’ai mon vieux Casque d’Or, la tête de Bubu. Peuple aimable et auquel on ne saurait être trop reconnaissant d’avoir pris parti pour nous, sans arrière-pensée, et au moment où nos affaires allaient le plus mal».
Le 2 septembre : «Il est dix heures. Je reviens de l’École de Guerre où nous sommes allés inspecter les cadets à sept heures du matin. Les matins et les soirs ici sont si délicieux qu’on se lève volontiers et qu’on se couche avec peine. Jamais un nuage, pas de vent, et cependant l’air le plus pur, agité un tout petit peu, embaumé… Ce soir, réception du Président de la République. Demain dimanche, repos général. Le dimanche s’appelle ici ‘jour inutile’ et nous avons une course de taureaux».
Le 4 septembre : «Nous sommes allés déjeuner à Sintra, qui est à trente kilomètres, par une route qui m’a cahoté et endolori un peu mon appendicite. Mais en revanche, une fois arrivé, le soleil, le vent, la montagne et des oasis de palmiers, de fougères géantes et d’eucalyptus… Il y a à l’hôtel quelques officiers de marine français, très gentils et je vais quelquefois avec eux me promener sur le port. C’est la belle partie de Lisboa, le grand fleuve bordé de palmiers et de petits palais Louis XV rouges et blancs… Je ne crois pas que nous restions très longtemps ici. Trois semaines au plus…»
Le 11 septembre : «Nous sommes toujours contents de notre travail. Certainement nous serons de retour fin septembre. Les soldats semblent fins, trop propres, gentils ; il y a la question des officiers, mais il ne faut pas être un aigle pour faire la guerre. Nous entamerons les discussions finales cette semaine avec les Ministres et il n’y aura plus ensuite qu’à attendre la réponse de Paris. Dans huit jours nous irons sans doute nous établir dans un camp pour voir une division mobilisée. Les officiers toujours très gentils, aussi gentils que peuvent l’être des officiers bien élevés, mais ne sachant pas donner à leurs lieutenants la liberté qu’on trouve si bien dans la marine… Visite à midi aux magasins de drap gris dans un vieux palais manuélin, avec des plafonds vert-et-or. Visite ce soir à l’Ambassade d’Angleterre et nous irons aux environs dans un jardin tracé par un Français en 1715».
Le 15 septembre : «…simple et silencieuse, et qui n’a dit que cela dans la soirée. Mais que c’est triste, mon amie chérie, d’être loin de la guerre et de toi, petite guerre civile. Pas de soldats permissionnaires dans les trains. Jamais un aéro. Jamais une détonation étrange. Jamais un pauvre embusqué lisant son journal dans le tramway. Jamais un journal. J’attends avec impatience la fin du mois».
Le 18 septembre : «Nous n’attendons plus que la réponse de notre Gouvernement, car notre rapport est fait et les dernières discussions seront rapides, car nous avons été reçus avec une bienveillance et occupés avec une célérité rare dans ce pays. Le général veut repartir le plus tôt possible car il attend un commandement et mon colonel aussi. Je ne parle pas de l’aide de camp anglais qui soupire après Béthune. J’espère que nous obtiendrons de l’Angleterre ce que nous désirons, car les soldats portugais sont dociles, résistants (et si soignés, si propres, les mains toujours nettes) et feront bien meilleure figure que d’autres… Aujourd’hui repos, j’irai travailler un peu à la Légation et écrire à Berthelot. Dîner chez le Ministre. Ce sont des corvées généralement assommantes et comme je ne mange pas, je reste oisif et muet entre deux officiers portugais dont je ne comprends pas le français et qui ne comprennent pas non plus le mien. Je crois que nous aurons des manœuvres du côté de Porto cette semaine».
.
D’autres lettres suivront. Jean Giraudoux attendra jusqu’en novembre pour voir se finir sa mission au Portugal.
Après la guerre, il devient en 1920 Secrétaire d’Ambassade de troisième classe et dirige le Service des Œuvres françaises à l’étranger, puis le Service d’information et de presse au quai d’Orsay, il y rejoint un de ses amis d’enfance, le diplomate Philippe Berthe.
.
D’une guerre à une autre
Le 9 juin 1940, Jean Giraudoux conduisait son fils, Jean-Pierre, au Régiment d’infanterie de Dijon où celui-ci était mobilisé. Jean reproche à Jean-Pierre d’avoir serré la main du Colonel, geste qu’il jugeait peu militaire. Jean-Pierre répond à son père : «Mais, papa, il me l’avait tendue !»
Le 19 juin 1940, alors que Jean Giraudoux, Ministre plénipotentiaire, se trouve à Bordeaux avec le Ministère des affaires étrangères, Jean-Pierre déserte à Bayonne, pour répondre à l’appel du Général de Gaulle. Il traverse l’Espagne, s’arrête quinze jours au Portugal, puis se présente à Londres au Général de Gaulle et après avoir quelque temps espéré retrouver son père et faire le point avec lui, il rallie les Forces Navales Françaises Libres.
Dès que Vichy fut un fait, Jean Giraudoux démissionna de son poste du Ministère de l’information, hésitant cependant à entrer dans la Résistance de l’intérieur ou à l’extérieur de la France.
Jean Giraudoux, accompagné de Suzanne, sont épouse, part à la recherche de Jean-Pierre, voyage source de son livre «Portugal» dont peu avant sa mort, il prépare la publication. Jean Giraudoux avait-il des remords par rapport à ce qu’il a dit à son fils ou la raison est-elle autre de partir à sa recherche ?
Jean Giraudoux séjourna au Portugal de septembre à octobre 1940, dans l’espoir de retrouver son fils. C’est son second séjour, le premier remontant à 1916. Dans le texte poétique «Portugal», Jean Giraudoux compose un hymne à ce pays refuge, consolation d’une Europe effondrée. Ces très belles pages aboutissent à une sorte de révélation : la lumière, les couleurs du Portugal, rendent la vue à l’écrivain qui se tait au profit de la prosopopée du bégonia qui donne une leçon de paix aux hommes.
Dans la lettre, en date du 18 septembre 1940, que Jean Giroudoux écrit de Lisboa à son fils, Jean-Pierre, on comprend que l’écrivain, dramaturge et diplomate aurait souhaité que son fils combatte de l’intérieur et pas de l’extérieur, de Londres, alors que le fils, au contraire, espérait que son père rejoindrait De Gaulle à Londres.
Encore à Lisboa et sachant que son fils était parti pour Londres, il lui écrit : «je ne sais comment je vais retrouver la France en rentrant… Notre mission est de résister de tout notre cœur puisqu’il n’a pas été permis de résister de toutes nos armes… Tu as encore la chance d’être dans un pays qui se bat, mais chez nous, le combat est à reprendre et tu n’y serais pas, non plus, inutile».
.
Le récit de Jean Giraudoux sur le Portugal ne sera publié qu’en 1958, après le décès de l’auteur et est composé de 6 petits chapitres : Elvas, Lisbonne, Monte Estoril, Alcobaça, Le miracle de Viseu et Monologue du Bégonia. Le livre parle sur ces lieux, toutefois, le plus souvent, ces lieux sont des lieux où il écrit, plutôt que des lieux sur lesquels il écrit sur le Portugal, sur sa quête.
Voici quelques citations que nous avons choisis dans le livre «Portugal» de Jean Giraudoux :
Le livre commence par Elvas : «Tout ce qui est blanc est blanc pur, ce qui doit être rose est rose-rose. Tout ce qui des maisons est bleu, semble à jour sur l’horizon, et ces fenêtres dans cette façade azur sont les premières fenêtres que je vois dans le ciel. Voilà le seul pays d’Europe où la couleur ne se soit pas ternie depuis un an dans les mains humaines…».
Jean Giraudoux espérait-il rencontrer son fils au Portugal, trouver des traces, marcher sur ses traces, son fils étant parti de France depuis fin juin, alors que lui, après la traversée de l’Espagne, n’arrive au Portugal qu’en septembre : «Voilà que ma vue, depuis deux mois absente, m’est rendue par cet or qui soutache les remparts d’Elvas. Depuis deux mois, la même lueur sans lueur m’éclairait, tous mes vitraux à moi aussi m’avaient été enlevés… Voilà le Portugal qui me rend la vue… Quel pays me rendra le toucher, l’ouïe, le goût, je ne sais pas ; mais pour la vue c’est fait. Je vois sur cette petite église le plus grand coq en fer du monde. Il a des clous d’or sur son collier…»
Toujours dans le chapitre Elvas, Jean Giraudoux écrit sur son fils : «C’est tout nu qu’il a fait ses serments, ses adieux, comme un Gaulois avant Gergovie. Maigre aussi comme il n’avait jamais été, et il est parti de France dans sa forme la plus juste, mais avec des vêtements d’un autre. D’un autre, si j’en crois ceux qui me le décrivent, qui avait un veston minuscule, des pantalons trop étroits fendus par le couteau aux chevilles, mais des souliers immenses… Aucun de ces objets qu’on oublie parfois sur sa route et qui dénoncent votre piste… Il m’avait confié depuis longtemps sa montre de voyage, son stylo, son carnet de chèques…»
Des traces de son fils qu’il aurait souhaité trouver, une quête de l’impossible ? «Si dans Notre-Dame de Pilar (1), j’ai trouvé un gigantesque soulier, pendu en ex-voto, une ficelle pour lacet, oui, il n’était pas loin. Si dans le linge que cette gitane devant Alcale fait sécher sur de l’ocre, il y avait une chemise débordant les fossés du champ, c’était lui… Mais le livre français trouvé sur la route que me montre l’hôtelier à Trujillo est le livre d’un auteur qu’il exécrait… Sur le bel asphalte que l’Espagne et le Portugal étalent tout fumant encore devant l’exode, aucun pas n’a marqué, même pas comme l’exigeait la vraisemblance de cette époque fabuleuse, la semelle géante de l’enfant que je cherche…».
Ils arrivent à Lisboa. Le récit commence ainsi : «Et maintenant c’est Lisboa, où Saint Antoine de Padoue est né, où il a été enfant de cœur, dans un chœur qui a respecté le tremblement de terre, et où grâce à lui tout se retrouve. Sur le Rossio s’est retrouvé tout… Voilà deux vieillards qui se tiennent par la main : l’un vient d’Ostie, l’autre de Monaco. Ils se sont pris pour la première fois la main à Bilbao, ils ne l’ont plus lâchée. Si vous voyez un passant seul, c’est qu’il ne vient pas de l’Europe… c’est qu’il arrive du Nouveau Monde, qu’il pense lui-même, qu’il parle à lui-même… Soudain, il s’arrête, curieux, car Miss Europe elle-même, avivée par les malheurs de l’Europe, vient de l’effleurer en costume de deuil de l’Europe… l’Europe a perdu ou laissé choir… La place est pleine. Les pigeons circulent… Ça et là, vous apercevez des têtes que vous connaissez, que vous avez vues à Paris, Vienne, Berlin… Les Juifs sont ceux qui parlent le plus haut… pour faire croire sans doute qu’ils sont chez eux et que huit jours à Lisboa les ont changés en Juifs lusitaniens, la noblesse des Juifs, qui n’ont pas voté la mort du Christ. Ils passent vite devant l’autocar qui amène les Juifs de Suisse par un itinéraire clandestin… et sur tous ces visages, au-dessus des couches d’anxiété, de deuil, d’injures, s’étale comme une paix suprême, la sérénité d’être dans un pays qui a le coton et le fil. Où il y a cette liberté ravie depuis des mois : le choix. On peut choisir entre trente sortes de sardines, les trois sortes de…».
Le 21 septembre, de Monte Estoril Jean Giraudoux écrit : «Mais voilà l’après-midi, nous discutons, nous buvons et pour les convives la leçon a été vaine. Déjà ce départ entre le bien et le mal, le faux et le réel que la barre entre l’été et l’automne avait tirée entre eux s’est effacée dans le repas…».
Et voilà qu’Alcobaça arrive : «J’ouvre les journaux portugais et je crois mal lire. La seconde colonne est à Serrano Suner et à Mussolini, la troisième à Hitler, la quatrième à Churchill. Et 278 avions ont été abattus dans la journée. Et Berlin est bombardée. Et l’on se bat en Indochine…Mais mes yeux ne quittent pas la première colonne. Elle m’apprend ce que seule la presse portugaise est assez sensible et courageuse pour révéler au monde en ce moment : la mort de Lavedan (2). Lavedan ce matin, devant Alcobaça, l’emporte sur la guerre et ses dieux… Alcobaça m’ouvre une nef immense. Dans le cloître du silence, le lavabo des moines filtre le silence même. Un rayon de soleil coule de l’un à l’autre tombeau, comme le ruisseau auquel Pedro confiait ses lettres à travers la prison d’Inès…».
Arrive le chapitre, le Miracle de Viseu. Peut-être le plus parlant, le plus symbolique, le plus long, celui de la vérité. Du soi ? Cela commence ainsi : «La nuit tombait sur Viseu. Je l’ai entrevue sur sa montagne, dans ses remparts, dans ses couleurs, à croire que pour mon dernier soir au Portugal, on préparait la nuit portugaise. Terrasses à palmiers, chapelles en grenat, rivière de lune, décor et lumières étaient prêts pour que ce pays me dise adieu dans son langage. C’est une phrase qu’hier au départ de Lisbonne m’a crié du trottoir Manuel… Le bruit des pays de notre procureur et de notre directeur de la Société Générale discutent de Valéry sur l’asphalte de la place du Centenaire est fait sur la mosaïque de la Praça da República par deux étudiants de Coimbra en cape qui mènent peut-être d’ailleurs le même débat… Ils viennent vers moi. Ils me regardent… Alors se déclare le Miracle de Viseu… Les gens de Viseu ne m’embrassent pas, comme mes amis de Lisbonne. Ils ne me demandent pas, comme mes amis de Lisbonne. Ils ne demandent pas mes papiers comme l’agent de police d’Évora, pour y lire que je suis Français et m’en félicitent, seules félicitations reçues par ma patrie depuis quatre mois… En vain, je cherche à ranimer en moi le sens du voyage. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, quel que soit son costume ou son type, ne m’apporte rien de lui et tout de moi. Je suis sans doute dans un de ces soirs où votre vie vous regarde ; le temps est dur, la semaine cruelle… Viseu est-elle ainsi pour tous les visiteurs ? M’a-t-on commandé de la voir comme on me recommande les sites à écho, les points de mirage ? Est-elle la ville où l’on circule dans une connaissance universelle de soi-même ? Au terme du voyage où j’ai découvert la ville où l’on ne distingue pas les Juifs, celle où l’on ne distingue les pauvres, celle où l’on ne distingue pas le vaincus, le Portugal m’offre celle où l’étranger est soulagé de l’opacité, où il est transparent où ses secrets en congé vaguent. Car ceux-là de Viseu ne savent pas seulement que je suis bon ou mauvais, courageux ou lâche, ils savent mes moindres actes dans ce début d’octobre, sous cette même lune, ils le savent. Ce bourrelier, qui lit son journal parce qu’il ne sait pas dans quel district Salazar va suivre les manœuvres, sait que j’allais pêcher les écrevisses dans le Nahon, avec mon père. Car les gens de Viseu connaissent mon père et le père de mon père… Et ce M. Camões, – son nom est sur sa devanture, donc je sais que ce n’est pas lui qui a écrit Les Lusiadas – sait que sur le chemin qui nous ramenait de Nahon mon cœur se serrait d’amour et de désespoir près du domaine appelé Émile à cause d’un petit cheval blanc qui était là et qu’on me permettait parfois de monter, qui avait dix-huit ans, moi dix, qui ne me survivait pas. M. Camões devait bien me dire son nom, je l’ai oublié… Plus personne et me voici dans la rue la plus ancienne, dont Manuel m’a prescrit de regarder les portes, célèbres par ses heurtoirs. De chacune je m’approche, sur chacune est cloué un heurtoir de bronze, une main, un cyclope, un lion de dos…».
Le livre se termine par le Monologue du Bégonia : «La fleur montagne appelée Serra da Estrela que vous voyez là-bas sous la lune est de mon avis, jamais elle ne verra la Serra de Cabrera et les fleurs étoiles le sont, et si vous trouvez, là-haut, en levant les yeux, une seule étoile qui côtoie le sang des étoiles, et qu’on va voir dans quelques milliards d’années, car l’odeur va moins vite que la lumière, ce qu’est la pourriture et la puanteur des étoiles… Au centre même du massif, où les lychnis faisaient menu, où il apporta ce que les fleurs sont les premières à reconnaître aux hommes, le volume et la parole, car il pourra parler les jours de vent, ce sera sans danger, et, quelle récompense si celui qu’il a cherché en vain dans ce pays, à son retour un jour le découvre, cueille de lui son premier fruit, assoiffé s’en délecte, et combien sa joie sera-t-elle plus vive de la trouver debout plutôt qu’à étendu dans la terre».
.
Le livre a pour titre Portugal, toutefois, la deuxième partie de l’œuvre s’intitule «Combat avec image».
La lettre, en date du 18 septembre 1940, que Jean écrit de Lisboa à son fils, Jean-Pierre, ne sera lue par ce dernier, probablement, que lors de l’édition du livre en 1958.
Jean Giraudoux ne reverra plus son fils Jean, parti à Londres rejoindre De Gaulle. L’écrivain meurt le 31 janvier 1944 dans le 7ème arrondissement de Paris.
Le 24 janvier 1944 Jean Giraudoux rencontre Aragon. Le lendemain, alors qu’il se trouvait à l’Opéra-Comique, il fait un malaise le contraignant à regagner son domicile, Quai d’Orsay, où il a vécu une agonie épouvantable. Un proche, lui demandant si on avait voulu le tuer, Jean répond oui en clignant des paupières. Au lendemain de sa mort, Aragon écrivait : «Jean Giraudoux empoisonné par la Gestapo». Une façon un peu plus discrète, pour la Gestapo, d’assassiner quelqu’un de connu ?»
En 1911, le tronçon compromis entre la rue La Pérouse et l’avenue Kléber, à Paris, reçoit le nom d’Avenue de Sofia. Le royaume de Bulgarie étant allié de l’Allemagne durant la Grande Guerre se voit sanctionné. L’avenue Sofia devient avenue du Portugal, avant même la fin de la guerre, le 14 juillet 1918. La partie comprise entre les rues Dumont-d’Urville et La Pérouse, prolongement de l’avenue du Portugal, prend le nom de Avenue Jean Giraudoux.
Simple coïncidence ?
Une mise en évidence des bonnes relations entre le Portugal et la France, Jean Giraudoux y ayant contribué à sa façon, à sa manière, avec les deux visites et y a écrit «Portugal».
.
(1) À Saragosse (Espagne) (?)
(2) Henri Lavedan né à Orléans et mort à Ecaquelon le 3 septembre 1940 est un journaliste et auteur dramatique français. Il a dirigé la publication «Illustration» entre 1908 et 1921.
– Les chapitres du livre «Portugal» de Jean Giraudoux ne sont pas décrits chronologiquement : le chapitre Alcobaça, dans le livre, vient après Lisboa, Monte Estoril par exemple. Ce dernier étant visité le 21 septembre, à Alcobaça on parle du décès de Lavedan qui a eu lieu le 3 du mois.























Gostei muito do seu texto.