Il y a plus d’un demi-siècle…
C’était en septembre…
Je me livre à vous chers lecteurs !
Ce que je vais vous raconter c’est l’histoire d’un portugais immigré et de sa famille. C’est une histoire, parmi les quatre millions d’histoires qui restent à écrire des portugais expatriés, des portugais émigrés.
Voici en quelques paragraphes l’histoire do ‘salto’, le saut familial et des quelques années qui s’en suivirent :
Début des années 60, des centaines de milliers de portugais franchissent les frontières à la recherche d’un emploi et parfois d’asile. Ils deviennent pour les villageois restés au pays «os franceses», «les français».
Parmi eux mon père, qui nous quitte en 1964.
C’était le premier dimanche de septembre, dimanche de fête paroissiale, Notre Dame des Nécessités, la bien nomée. Cette année-là, la fête était organisée par les cinq frères Marrucho, ils avaient été désignés un an auparavant comme «mordomos», majordomes de la fête. Ce fut également jour de mariage dans la famille.
En septembre, les montagnes de Estrela et Gardunha apportent un peu de fraîcheur, les jours deviennent plus courts. Conditions idéales pour faire le «Salto», le «saut».
La nuit venait de tomber et le feu d’artifice retentissait, tandis que ma mère pleurait en silence, sans que je sache pourquoi. Mon père venait de m’embrasser en me disant : «je vais travailler à l’usine, demain je reviendrai et nous irons à la fête».
Mais pourquoi pleurait alors ma mère ? Ce fut pour moi une longue nuit d’interrogations. Celles-ci furent vite dissipées dans la matinée lumineuse d’un lundi de fête, pas comme les autres.
Très tôt, des oncles vinrent parler à ma mère d’un ton très bas, tandis que j’apprenais quelques heures plus tard de la bouche d’un ami, que mon père venait de partir au-delà de la montagne, en direction de la France.
J’étais fière de mon père, toutefois je lui en voulais de ne m’avoir pas dit que le petit sac dont il se servait habituellement à transporter son repas à l’usine, constituerait cette fois-ci l’unique bagage pour son long voyage qui l’emmènera en France.
J’ai compris bien plus tard, le besoin de silence dans les premières heures de ce long voyage et qu’à 6 ans on n’est pas prêt à tout comprendre. L’amour du père me manquera, ainsi que la sucette ou la petite glace de sirop, des dimanches après la messe.
Huit jours après le départ et à la suite de maintes péripéties, quatre «alcarienses» arrivent à Paris avec comme seule indication, une adresse, qu’ils transmettent à un chauffeur de taxi. Celui-ci ne se pose et ne pose pas de questions, concernant le payement de sa course jusqu’à Roncq, 300 kilomètres au Nord de Paris.
Sur la route, celui qui deviendra leur guide pendant quelques heures, s’arrêta même pour acheter des tomates, qui furent plus qu’appréciées par les quatre copains qui travaillaient au Portugal dans une briqueterie et qui au même temps cultivaient au bord du fleuve Zêzere, cet aliment qui est venu, à ce moment précis, apaiser leur faim.
Pour venir en France, pour faire le saut, mon père a payé au passeur 9.000 escudos, ce qui correspondait à l’époque à 6 mois de salaire.
Alors que la France a commencé pour eux, à Hendaye, ironie du sort et des circonstances, le long voyage en taxi, les conduira à la frontière franco-belge où un ami du village les accueille bouche bée, ne comprenant pas comme ils purent arriver jusque là.
A l’époque il n’y avait évidemment pas de portables, peu savaient écrire, et téléphoner était parfois du domaine de l’impossible ou de l’aléatoire. La réponse qu’ils ont pu donner : «l’adresse?….. Nous l’avons eu de ton épouse».
Le lendemain ils ont été conduits au Commissariat de Police pour faire la demande du Permis de séjour.
Le surlendemain ils étaient au travail.
Ont été là, au milieu des «trente glorieuses».
Après trois ans d’hésitations ma mère, ma sœur et moi avons fini par rejoindre légalement mon père. Le voyage ne durera que 48 heures par le train. En France l’usine de mon père avait fait construire, tout spécialement pour nous, depuis un an et demi, une maison préfabriquée.
A l’époque c’était du luxe, en comparaison avec le début des bidonvilles de Saint Denis, Champigny et bien d’autres, occupées et crées par des immigrés portugais.
Le séjour en France ne devait durer, pour mes parents, que de 3 à 4 ans. Ce fut la raison pour laquelle ma sœur et moi repartîmes faire des études au Portugal. Au début on me disait, pourvu que tu réussisses ton Certificat d’études, puis ce fut le BEPC et plus tard le BAC.
En repoussant toujours plus loin la fin de mes études et mes parents leur séjour en France, nous voilà un demi siècle après. Mes parents malheureusement ne sont plus des nôtres. Eux, qui ont toujours travaillé comme ils disaient «pour nous donner une meilleure vie», nous ont transmis l’amour pour notre pays de naissance, le Portugal, mais également pour notre pays d’adoption, la France.
Mon père: un ouvrier parmi des millions d’ouvriers immigrés
Mon père a commencé comme ouvrier. Très vite il a progressé pour devenir contremaître après quelques années de présence en France.
Malgré ses responsabilités, il s’est toujours senti un ouvrier parmi les autres ouvriers. Il était au service. Au service de son patron et des collègues de travail.
Pour lui son travail n’était jamais terminé, il aimait apprendre et partager son savoir. Pour y arriver, il ne ménagea pas ses efforts.
Lui qui n’avait que le certificat d’études primaires, jusqu’à sa mort il soigna l’élégance de son écriture, c’était un perfectionniste à sa manière.
Il ne fut pas un fervent lecteur de littérature classique. L’éducation familiale, le peu de scolarité, ainsi que le manque de temps libre expliquent ce non choix. Jusqu’à son départ pour l’armée il a partagé son enfance et adolescence entre l’école, le travail des terres, en marchant notamment à l’intérieur d’un puits sur une noria pour faire sortir l’eau et ainsi irriguer les champs. Le soir, il travaillait dans un métier à tisser artisanal, à la lumière d’une lampe à l’huile.
En France, il a mis un point d’honneur à écrire le mieux possible dans la langue de Molière. Un petit dictionnaire de français, ainsi qu’un autre bilingue français-portugais étaient ses livres de chevet.
Il tenait à ce que nous restions proches de nos racines culturelles. Moi et ma sœur, avant de repartir au pays pour faire nos études, avons vécu deux ans en France avec nos parents, à la fin des années 60. Pour ne pas oublier et pour que je me perfectionne dans l’écriture de Camões, il me faisait des dictées.
Je vais vous avouer un secret… cela reste du domaine de l’anecdote, toutefois cela me marquera : de 1968, je garde le souvenir de l’événement de mai et de celui, plus personnel, que je vais vous raconter.
De mon père, pendant toute sa vie, je n’ai reçu qu’une seule fessée. La cause? Une simple dictée. Il essayait de me mettre sur la voie, toutefois, devant mon entêtement dans l’écriture de la conjonction ‘et’ qui se dit ‘i’ en portugais, mais qui s’écrit ‘e’, il se fâcha et fit le geste en me donnant une fessée. Ce geste le rendit malade au point qu’il alla tout de suite se coucher sans manger.
Mon père accepta pendant toute sa carrière de travailler bien souvent au-delà de la limite horaire contractuelle, pour résoudre tel ou tel autre problème. Voulant aider les ouvriers qui comprenaient moins que lui, il accepta de travailler jusqu’à 16 heures de suite, voire parfois plus.
Il accepta même d’aller visiter d’autres usines, chercher du savoir et de l’expérience. Déplacements qu’il faisait accompagné de son patron.
Par la force des choses, manger au restaurant avec son patron était parfois un peu compliqué.
En déplacement, il racontait, qu’il était parfois bien embêté lorsqu’il fallait, par exemple, manger un artichaut, une choucroute et tout autre plat non portugais. Son secret ? Attendre, être patient, pour voir comment, par exemple, prendre les feuilles de l’artichaut, et quoi manger dans un artichaut. Cela aussi a fait partie de son apprentissage en arrivant en France.
Une anecdote : la famille, quelques temps après son arrivée en France, a acheté deux boîtes de choucroute. N’étant pas habitués au goût de cet aliment et pensant que ce que nous venions d’acheter était avarié, nous l’avons jeté. Nous avons compris, plus tard, et suite à l’expérience de notre père, que la choucroute que nous avions achetée n’était pas avariée et qu’il fallait là aussi s’habituer et éduquer notre palais à d’autres goûts, à d’autres coutumes, à d’autres mœurs.
Je vous raconte ici, des choses simples de la vie, elles laissent toutefois des marques et des souvenirs. Il a fallu trouver des ressources pour s’habituer et s’adapter. L’immigré sera toujours un apprenti. Apprenti dans le pays qui l’a accueilli, et apprenti dans son pays d’origine. Il lui est parfois difficile de comprendre l’évolution de son pays natal, restant souvent avec une image un peu figée du passé.
Le silence et le secret que mon père garda avant de faire le «saut» pour la France, je le comprends mieux aujourd’hui.
Pour la réussite de son projet, garder le secret était essentiel et vital. Mon père aurait pu être emprisonné par la PIDE, la police politique du régime totalitaire et fasciste d’Oliveira Salazar. Régime qui a maintenu le Portugal pendant presque 50 ans dans l’obscurantisme, en le coupant au même temps du monde.
Me viens ici à la mémoire… un membre de ma famille, mon oncle José.
Il a été emprisonné sous le régime de Salazar. Il tenait une taverne dans notre village. Son crime ? Le fait de recenser les familiers et amis désireux de chercher ailleurs de meilleures conditions de vie, pour eux et pour leurs proches.
Il transmettait leurs noms et coordonnées à un Passeur. L’oncle fut compagnon de cellule de Mário Soares, ce dernier ayant été emprisonné13 fois…
Mário Soares a été le membre fondateur du Parti Socialiste portugais. Il occupa le poste de Premier Ministre et de Président de la République après la Révolution des œillets.
En visite à notre région, la Beira Baixa, deux ou trois ans après la Révolution des œillets, mon oncle s’est retrouvé face à face avec Mário Soares. Leur embrassade restera dans l’histoire de la famille. Des souvenirs leur sont venus sûrement à la mémoire, le temps de ce geste d’amitié.
Les Marruchos n’avaient pas de convictions marquées en politique, toutefois, nous avons appris très récemment que notre tante, épouse de l’oncle José, a gardée tout le restant de sa vie une gratitude immense envers Maria Barroso, épouse de Mário Soares. Alors qu’elles visitaient au même moment leurs époux en prison, Maria Barroso, par compassion pour ma tante qui était dans la difficulté et dans une grande détresse, lui a fait don des économies qu’elle avait dans son sac à main. Voilà un geste qui marquera une vie.
Pour moi, enfant de 11ans, il fut bien difficile d’admettre, en regardant la télévision chez un voisin ici en France, de l’arrivée des Américains sur la lune. Le régime de Salazar et les années de scolarité faites au Portugal, nous avaient inculqué l’idée que l’extraordinaire ne pouvait être fait que par des Portugais.
Un demi-millénaire c’était écoulé depuis le début des Découvertes, toutefois elles servaient à justifier la politique de l’époque et à donner un sens au slogan «le Portugal est un petit pays en Europe, mais un grand pays dans le monde».
Me vient ici à la mémoire la pièce de théâtre à laquelle j’ai assisté il y a quatre décennies, «Rhinocéros» d’Eugène Ionesco, interprétée par Jean-Louis Barrault et son épouse Madeleine Renault. On y comprend à quel point nous pouvons être manipulés. Manipulations qui peuvent, parfois, conduire à des drames horribles.
Que ce fut dur, un matin de notre enfance en 1969, de nous réveiller et de voir sur le mur de notre préfabriqué, à Roncq, des croix gammées. Nous nous sommes sentis visés, sans savoir par qui. Quelqu’un, dans un pays qui avait su nous accueillir les bras ouverts, nous accusait personnellement de l’existence au Portugal, d’un régime totalitaire, celui de Salazar. Cet événement aura, malgré le choc, le mérite de nous éveiller à une certaine prise de conscience civique et aura son rôle sur nos convictions futures.
Mon père à maintes reprises a eu des offres pour changer de patron. Il a été victime d’accidents de travail. Les blessures physiques et même morales auraient pu le conduire au changement de patron et de métier. Fidèle à ses principes, il fit honneur de garder pendant toute sa carrière le même patron : il a travaillé en France toujours dans la même usine, une usine de Plastique à Roncq, l’usine Silvallac. C’était une manière de remercier et de rester fidèle à ceux qui l’ont accueilli en arrivant en France.
Ouvrier pendant toute sa vie, mon père fut homme de progrès à sa manière et bâtisseur. Bâtisseur d’un monde meilleur pour lui, mais surtout pour les siens. Là où il avait ses racines, le Portugal, il y bâtit une maison pour la famille. Il était à sa façon un chercheur. Chercheur d’un monde meilleur pour les siens et tous ceux qui l’entouraient.
Par ces actes et manière de voir la vie, on peut dire qu’il adopta la devise de la France : Liberté, Égalité, Fraternité. Mon père mettait en pratique au quotidien cette devise.
Des exemples :
Liberté : en nous encourageant et en nous laissant progresser dans nos études jusqu’à là où nous avons voulu. A l’époque la préoccupation de l’immigré portugais était d’économiser un maximum d’argent pour repartir au plus vite au pays, y construire une maison, témoignant ainsi de sa réussite, et/ou acheter une voiture pour montrer, ne serait-ce qu’inconsciemment, à son ex-patron du village, que lui aussi il a pu s’acheter une voiture. Faire travailler ses enfants à 16 ans était presque la norme.
Notre père nous a laissé la liberté du choix, à un moment donné de notre existence, de notre nationalité. Nous sommes devenus français en 1983. A l’époque, demander la nationalité française était considérée comme un outrage à notre pays d’origine, comme que renier la patrie. Dans la réalité, nous avons gardé les deux nationalités.
Égalité : A ses deux enfants de sexe opposés, il a toujours réservé le même traitement, les mêmes exigences et les mêmes encouragements.
Fraternité : En faisant venir d’autres membres de la famille et villageois du Portugal pour travailler dans son usine, il allant jusqu’à les héberger.
La solidarité était également sa devise. Dans la souffrance de certains de ses amis et de son épouse, il ne les abandonnera jamais, se privant parfois, à cause d’eux, d’une certaine liberté. L’hospitalisation des proches étant le dernier recourt ou en cas de nécessité vitale.
Solidarité, en recevant ou en visitant, les dimanches, la famille ou amis, malgré des horaires de travail de 3×8 heures.
Pour ses enfants et petits-enfants, il était toujours prêt à les recevoir et à répondre à leurs sollicitations. Il avait un réel plaisir et bonheur de les recevoir, leur préparer le repas dominical était pour lui comme qu’un très agréable devoir. Il aimait partager.
Son sens de la solidarité et de la souffrance allait bien au-delà de ce qui, selon nous, était raisonnable. Pour lui tout allait toujours bien, il ne se plaignait que très rarement. Il omettait souvent, pour ne pas nous préoccuper, de parler de sa souffrance physique et parfois morale. On devait jouer avec tact pour en savoir plus.
.
Par ce texte j’ai voulu rendre hommage à mon père et par-delà, à beaucoup d’autres pères portugais immigrés qui peuvent se reconnaître dans certains aspects de ce récit.
Voilà mon histoire, l’histoire de mon père, une histoire parmi des millions d’histoires qui restent à écrire sur les immigrés portugais !
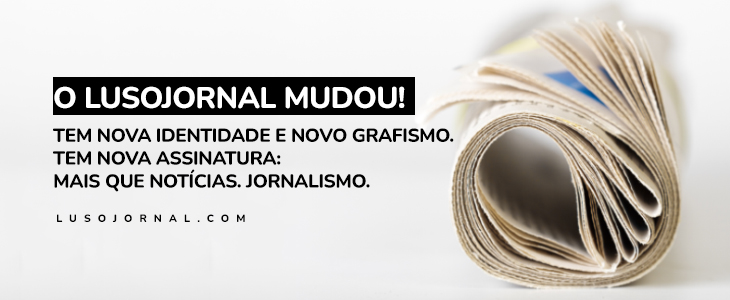






















Félicitations et merci beaucoup, Monsieur Antonio Marrucho !
Votre récit me fait du bien, je suis luso-descendant et né en France.
L’histoire que vous racontez de votre père rend effectivement hommage et honneur à tous ces parents portugais immigrés dont les miens faisaient partie.
Mon père a immigré à 22 ans en 1958 pour 2 raisons : la recherche d’un meilleur niveau de vie financier et professionnel (il partait avec un contrat de travail de chaudronnier-soudeur pour l’Allemagne) et surtout la fuite de la dictature fasciste de Salazar et des guerres coloniales.
Pour l’anecdote, mon grand-père a été emprisonné et sanctionné pour être communiste et avoir voulu appeler mon père Lénine ! Il a dû bien évidemment retiré le prénom de Lénine à mon père qui s’appela Rui.
Finalement celui-ci n’alla pas jusqu’en Allemagne, en route il rencontra des compatriotes qui lui ont conseillé d’aller avec eux sur Rouen. 2 ans plus tard, sa fiancée le rejoignit, ils se marièrent à Palmela puis je suis né 2 ans plus tard sous le prénom de Lénine, dans un pays libéral à l’époque (la France).
Voilà en quelques lignes l’histoire de mon père…
Bonjour Mme Lenine Caleira
Je vais partager mon témoignage dans une prochaine conférence
Je retombe sur votre commentaire
Je pense qu’il y a lieu de raconter votre histoire et celle de votre père qui me parait assez singulière
Serai-il possible que vous communiquiez vos coordonnées à lusojornal pour qu’on entre en contact avec vous ?
Je vous remercie par avance
Bien à vous
Antonio Marrucho
Merci a mon frère de ce beau témoignage . Tu as quelque chose de très en commun avec papa : un sacré gout pour l écriture et l histoire ….. Luisa Marrucho
Comme démocrate que je pense être, j’admets qu’on puisse avoir des idées différentes des miennes, toutefois Mr Luis Guerra votre commentaire me fait mal, comme mal a fait la torture que mon oncle José a subit à Caxias: la torture par la goutte d’eau. A 35 ans il nous est arrivé après 6 mois de prison comme un vieux avec des souffrances physiques et morales…J’ai de la nostalgie de ma jeunesse…mais pas de Salazar
… como disse,uma história “igual a tantas outras”,mas todavia uma história de vida e procura por um futuro melhor. Lamentável apenas,a referência errada a respeito de Salazar,usada por aqueles que o querem difamar,ou desconhecem o seu pensamento e actuação política,em prol da Nação que era Portugal.Nem a França,foi capaz de lhe ensinar e fazer ver,o quão Grande era Portugal.
belle histoire
bravo antonio