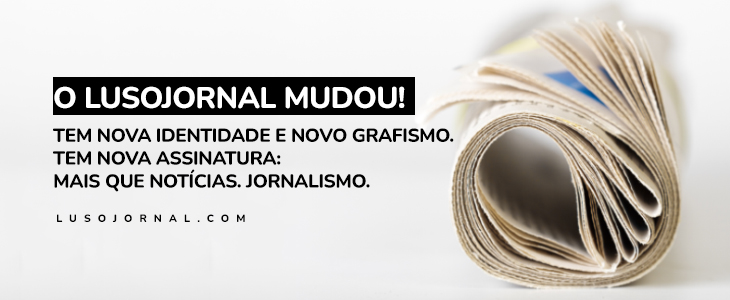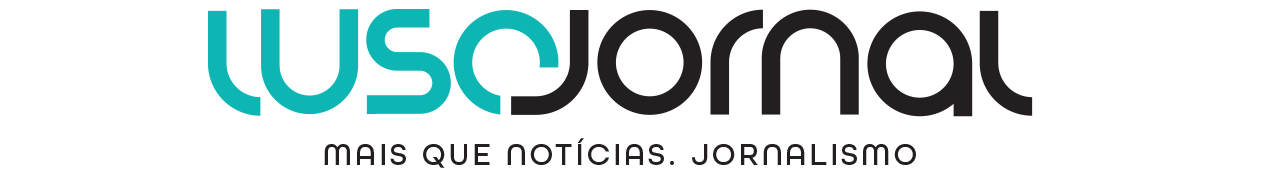Une des racines du Petit Prince est-elle au Portugal et plus précisément dans la banlieue de Lisboa, à Estoril ?
Il y a un dicton en portugais qui dit «Roma e Pavia não se fizeram num dia». C’est également le cas du livre le plus connu et le plus traduit au monde – 600 langues – de Saint Exupéry, «le Petit Prince».
Au tout début, il y a le désert, l’expérience de Saint Exupéry dans le Sahara, son atterrissage forcé dans la nuit du 30 décembre 1935 en compagnie de son mécanicien André Prévot.
Les trois années passées au Sahara.
Alors qu’il mange avec son éditeur américain en 1942, Saint Exupéry dessine sur la nappe un petit bonhomme. Séduit par cette silhouette d’enfant ailé, Reynald lui aurait proposé d’écrire un conte pour enfants, qu’il publierait à Noël.
Selon d’autres sources, depuis sept ans au moins, Saint-Exupéry envisageait d’écrire un conte de fées, dont le personnage principal aurait été un enfant… son frère François, peut-être, qu’il aimait tant, perdu si jeune et qu’il nommait, à l’époque, dans leurs jeux, «le roi soleil».
D’autres sources encore, pas souvent évoquées, situent le tout début de l’esquisse du «Petit Prince» dans l’hôtel Palace à Estoril.
Il y a probablement un petit bout de vérité dans tout ce qui vient d’être évoqué.
.
On vous décrit le passage de Saint Exupéry par le Portugal. Dans les cinq premières pages de son livre «Lettre à un otage», l’aviateur/auteur/reporter évoque le Portugal. Les écrits de Saint Exupéry sont beaux, émouvants, même si, parfois, on a un peu de mal à saisir la portée de ses dires : «Lettre à un Otage, plus qu’un chant à l’amitié (ce qu’elle est), c’est un chant à la vie et à la liberté; Saint Exupéry nous raconte sa vie dans le désert du Sahara, son rôle de correspondant pendant la guerre civile espagnole, dans le cadre de l’aventure humaine et sa relation avec ce combat, combat pour l’amitié, où il donnera sa propre vie».
Les biographies de Saint Exupéry disent : «En 1939, il sert dans l’Armée de l’air, étant affecté à une escadrille de reconnaissance aérienne. Après l’Armistice de juin 1940, il est démobilisé et quitte la France pour New York avec l’objectif de faire entrer les États Unis dans la guerre et y devient l’une des voix de la Résistance… Il part en novembre pour New York, où il arrive le 31 décembre, grâce aux passeports délivrés par Henry du Moulin de Labarthète…».
La vie de Saint Exupéry, même si courte, par sa richesse, ses activités, son oeuvre littéraire, les éditeurs et biographes oublient de dire qu’il a séjourné au Portugal, juste avant de partir pour l’Amérique, au moins entre le 28 novembre et le 20 décembre 1940, y rencontrant du beau monde. Lisboa devient plus sûr que Marseille, Lisboa remplace cette dernière dans le voyage conduisant en Amérique.
Avant son passage par Lisboa/Estoril, nous devons rappeler, sa rencontre avec son ami Léon Werth. D’origine juive, Léon Werth s’est réfugié à Saint-Amour, dans le Jura, où Saint-Exupéry lui rend visite avant de partir pour les Etats-Unis.
D’abord intitulée «Lettre à un ami», puis «Lettre à Léon Werth» avant d’adopter le titre définitif «Lettre à un otage», le texte dépeint la France qui souffre sous l’occupation allemande.
Grâce à la fiche remplie lors de l’arrivée et de son départ, on sait que Saint Exupéry a séjourné entre le 28 novembre et le 20 décembre 1940 au Palace Hotel à Estoril, banlieue de Lisboa, déclarant à l’époque habiter au 52 rue des Anges à Paris, son passeport étant délivré le 10 octobre de la même année à Clermont-Ferrand.
Construit dans les années 1930, luxueux, sophistiqué, intemporel, l’hôtel Palácio Estoril a été conçu par l’architecte Henri Martinet, bordé de magnifiques jardins. L’hôtel respire l’exclusivité et l’élégance, captivant les visiteurs.
Dans la présentation historique de l’hôtel, nous pouvons lire que «pendant la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel Palácio Estoril accueillait des familles royales européennes fuyant ce conflit armé», c’est pourquoi la région était surnommée ‘Costa dos Reis’. Les membres de la royauté, de la noblesse et de l’aristocratie d’Espagne, de France, d’Italie, de Bulgarie et de Roumanie ont fait de l’Hôtel leur résidence préférée. Également en raison de sa proximité stratégique avec la mer, l’hôtel a attiré des espions britanniques, allemands et français qui fréquentaient le bar d’Estoril. Tout cet environnement a contribué à inspirer Ian Fleming pour créer James Bond, le plus célèbre espion fictif. Le film ‘007-Au service de Sa Majesté’ a été tourné à l’Hôtel, en 1968, par Peter R. Hunter. Comme pour Ian Fleming et son James Bond, c’est au Bar Estoril que le pilote et espion français Antoine de Saint-Exupéry a commencé à écrire «Le Petit Prince».
Dans le registre de l’hôtel on peut effectivement consulter les fiches des personnalités importantes qui l’ont fréquenté, tels les ducs de Windsor, les espions Dusko Popov et Juan Pujol (lire ICI), les acteurs Leslie Howard et Orson Welles, le musicien Vinícius de Moraes et les écrivains Antoine de Saint Exupéry et Ian Fleming.
.
C’est à Estoril, en 1941, que Fleming, agent spécial au service des Aliados, s’est inspiré de Popov pour créer la figure de James Bond.
Dans le résumé que Françoise Gerbod en Bibliothèque de la Pléiade de «Lettre à un otage» de Saint Exupéry, nous pouvons lire que «on ne saurait imaginer plus belle déclaration d’amour. Seule la pensée de Léon Werth vivant dans son village de France peut lui donner corps. Seule son amitié peut faire qu’il ne soit plus un émigrant, mais un voyageur. C’est le thème central de ‘Lettre à un otage’. L’émigrant n’a plus de racines. Le voyageur, même s’il se trouve temporairement hors des frontières de son pays, reste orienté vers lui par toutes ses affections».
Le texte du petit livre est composé de six courts chapitres. Écrite de façon poétique, cette lettre mêle des références à son amitié pour Léon Werth et à son attachement à son pays.
Lors de la lecture du livre nous avons sélectionné quelques phrases, quelques citations. Il est évident, que, dans le choix fait, il y a un peu de nous, de notre perception. De manière volontaire, nous présentons ci-dessous, nos choix sans commentaires.
.
Le texte commence ainsi : «Quand, en décembre 1940, j’ai traversé le Portugal pour me rendre aux États-Unis, Lisbonne m’est apparue comme une sorte de paradis clair et triste. On y parlait alors beaucoup d’une invasion imminente, et le Portugal se cramponnait à l’illusion de son bonheur. Lisbonne, qui avait bâti la plus ravissante exposition qui fût au monde (1), souriait d’un sourire un peu pâle, comme celui de ces mères qui n’ont point de nouvelles d’un fils en guerre et s’efforcent de le sauver par leur confiance : ‘Mon fils est vivant puisque je souris…’»
«Regardez, disait ainsi Lisbonne, combien je suis heureuse, paisible et bien éclairée…».
«Le continent entier pesait contre le Portugal à la façon d’une montagne sauvage, lourde de ses tribus de proie ; Lisbonne en fête défiait l’Europe. Peut-on me prendre pour cible quand je mets tant de soin à ne point me cacher ? Quand je suis tellement vulnérable !…».
«À Lisbonne je sentais peser la nuit d’Europe habitée par des groupes errants de bombardiers, comme s’ils eussent de loin flairé ce trésor. Mais le Portugal ignorait l’appétit du monstre. Il refusait de croire aux mauvais signes. Le Portugal parlait sur l’art avec une confiance désespérée. Oserait-on l’écraser dans son culte de l’art ? Il avait sorti toutes ses merveilles. Oserait-on l’écrase dans ses merveilles ? Il montrait ses grands hommes. Faute d’une armée, faute de canons, il avait dressé contre la ferraille de l’envahisseur toutes ses sentinelles de pierre : les poètes, les explorateurs, les conquistadors. Tout le passé du Portugal, faute d’armée et de canons, barrait la route. Oserait-on l’écraser dans son héritage d’un passé grandiose ?…»
«J’errais ainsi chaque soir avec mélancolie à travers les réussites de cette exposition d’un goût extrême, où tout frôlait la perfection, jusqu’à la musique si discrète, choisie avec tant de tact, et qui, sur les jardins, coulait doucement, sans éclat, comme un simple chant de fontaine. Allait-on détruire dans le monde ce goût merveilleux de la mesure ? Et je trouvais Lisbonne, sous son sourire, plus triste que mes villes éteintes…»
«Mais le Portugal essayait de croire au bonheur, lui laissant son couvert, ses lampions et sa musique. On jouait au bonheur à Lisbonne, afin que Dieu voulût bien y croire. Lisbonne devait aussi son climat de tristesse à la présence de certains réfugiés. Je ne parle pas des proscrits à la recherche d’un asile. Je ne parle pas d’immigrants en quête d’une terre à féconder par leur travail. Je parle de ceux qui s’expatrient loin de la misère des leurs pour mettre à l’abri leur argent».
«N’ayant pu me loger dans la ville même, j’habitais Estoril auprès du casino…».
«Sans doute n’éprouvaient-ils rien. Je les abandonnais. J’allais respirer au bord de la mer. Et cette mer d’Estoril, mer de ville d’eaux, mer apprivoisée, me semblait aussi entrer dans le jeu. Elle poussait dans le golfe une unique vague molle, toute luisante de lune, comme une robe à traîne hors de saison».
«Je les retrouvai sur le paquebot, mes réfugiés. Ce paquebot répandait, lui aussi, une légère angoisse. Ce paquebot transbordait, d’un continent à l’autre, ces plantes sans racines…».
«De même que Lisbonne jouait au bonheur, ils jouaient à croire qu’ils allaient bientôt revenir».
«J’ai vécu trois années dans le Sahara. J’ai rêvé, moi aussi, après tant d’autres, sur sa magie. Quiconque a connu la vie saharienne, où tout, en apparence, n’est que solitude et dénuement, pleure cependant ces années-là comme les plus belles qu’il ait vécues. Les mots nostalgie du sable, nostalgie de la solitude, nostalgie de l’espace ne sont que formules littéraires, et n’expliquent rien. Or voici que, pour la première fois, à bord d’un paquebot grouillant de passagers entassés les uns sur les autres, il me semblait comprendre le désert. Un silence même n’y ressemble pas à l’autre silence. Il est un silence tendu quand le messager tarde à revenir. Un silence aigu quand, la nuit, on retient son souffle pour entendre. Un silence mélancolique, si l’on se souvient de qui l’on aime. Tout se polarise. Chaque étoile fixe une direction véritable. Elles sont toutes étoiles des Mages».
«Le Sahara est plus vivant qu’une capitale et la ville la plus grouillante se vide si les pôles essentiels de la vie sont désaimantés…»
«J’ai aujourd’hui besoin, pour tenter de m’exprimer mieux, de raconter aussi l’histoire d’un autre sourire…»
«Ça représente une belle cargaison d’expériences et de souvenirs, l’âge d’un homme !»
«Nous sommes l’un pour l’autre des pèlerins qui, le long de chemins divers, peinons vers le même rendez-vous…»
«Aucune synthèse valable n’est entrevue, et chacun d’entre nous ne détient qu’une parcelle de la vérité…»
«Le voyageur qui franchit sa montagne dans la direction d’une étoile, s’il se laisse trop absorber par ses problèmes d’escalade, risque d’oublier quelle étoile le guide…»
«Aucun d’entre nous ne détient le monopole de la pureté d’intention…»
«J’ai soif d’un compagnon qui, au-dessus des litiges de la raison, respecte en moi le pèlerin de ce feu-là…»
Le livre se termine par la phrase : «Il n’est pas de commune mesure entre le combat libre et l’écrasement dans la nuit. Il n’est pas de commune mesure entre le métier de soldat et le métier d’otage. Vous êtes les saints»..
Ne peut-on pas retrouver dans ce récit, qui commence par parler de Lisbonne, des dires prémisses, idées que Saint Exupéry développera dans Le Petit Prince ?
Le petit livre «Lettre à un otage», cet otage étant la France… étant son ami Léon Werth.
Dans la dédicace du Petit Prince, Saint Exupéry écrit : «À Léon Werth. Je demande pardon aux enfants d’avoir dédié ce livre à une grande personne. J’ai une excuse sérieuse : cette grande personne est le meilleur ami que j’ai au monde. J’ai une autre excuse : cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J’ai une troisième excuse : cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d’être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l’enfant qu’a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. (Mais peu d’entre elles s’en souviennent) Je corrige donc ma dédicace : À Léon Werth quand il était petit garçon».
.
Pour l’histoire, du passage de Saint Exupéry par Lisboa et Estoril, de notre consultation de la «liste ou manifeste des voyageurs étrangers contrôlés par l’inspection de l’immigration des États-Unis au port d’arrivée» de précieuses informations sur Saint Exupéry :
– Il a embarqué à Lisboa le 20 décembre 1940 dans le bateau Siboney
– L’arrivée prévue le 30, a eu lieu le 31 décembre 1940 dans le port de New York
– Il avait 40 ans, déclaré écrivain, né à Lyon
– Passeport émis le 21/10/1940 à Lyon (dans la fiche de l’hôtel il est dit 10 octobre 1940 et dans la littérature/biographie on dit, passeports délivrés par Henry du Moulin de Labarthète, à Clermont-Ferrand)
– Dernière demeure : Château d’Agay à Saint Raphaël (à hôtel Palace Estoril, Saint Exupéry avait déclaré probablement l’adresse sur le passeport) : 52 rue Michel Ange à Paris.
– Précédent voyage aux États-Unis : Juillet 1939
– Voyage pour rejoindre l’éditeur Reynae £ Hitchcock au 386 Fourth avenue à New York
– Lieu où il va séjourner : Hôtel The Ritz – Carlton (Central Park) à New York
– On a même des informations sur son hauteur, couleur de cheveux, etc.
En consultant, la dite liste, nous apprenons que, dans le même bateau a embarqué à Lisboa, destination de New York, le cinéaste Jean Renoir et sa seconde épouse, Dido Freire (2).
La première édition du Petit Prince a lieu en 1943 aux États Unis, l’éditeur étant Reynae £ Hitchcock.
Estoril honore Saint Exupéry avec une rue à son nom. La Prime School International Estoril, y est située.
Saint Exupéry a disparu en vol, au large des côtes marseillaises, le 31 juillet 1944.
Notes:
(1) Exposition du monde portugais (Exposição do Mundo Português) se tient du 23 juin au 2 décembre 1940 dans le quartier de Belém à Lisboa. Elle célèbre les 800 ans de la fondation du Portugal et les 300 ans de la restauration de l’indépendance vis-à-vis de l’Espagne. Une grandiose démonstration du régime de Salazar.
À la même époque, de passage aussi par Lisboa, le producteur de cinéma, George Rony écrivit sur l’exposition : «Ce qui m’impressionne le plus, c’est le fait que ce festival puisse coexister à juste quelques milliers de kilomètres des horreurs indescriptibles de la Guerre».
(2) La Grande Illusion, le chef-d’œuvre réalisé par Jean Renoir sorti en 1937 est motif de vives critiques de la part des partisans de Vichy. Le film est vivement critiqué, notamment par Louis Ferdinand Céline dans son pamphlet antisémite Bagatelles pour un massacre, au motif qu’un juif ne saurait être aussi sympathique que le lieutenant Rosenthal. C’est sur le bateau Jean Renoir va rencontrer le passager Antoine de Saint Exupéry, avec lequel il va travailler sur une adaptation du roman de celui-ci, Terres des Hommes, qui n’aboutira pas.