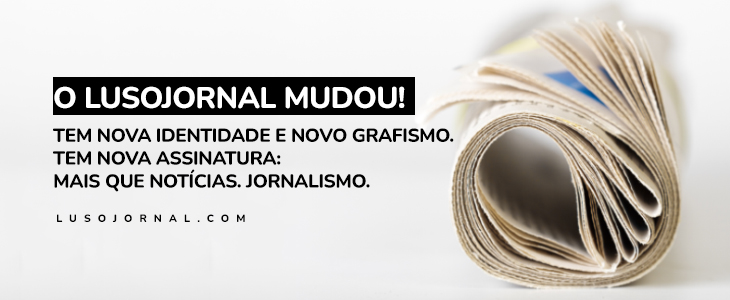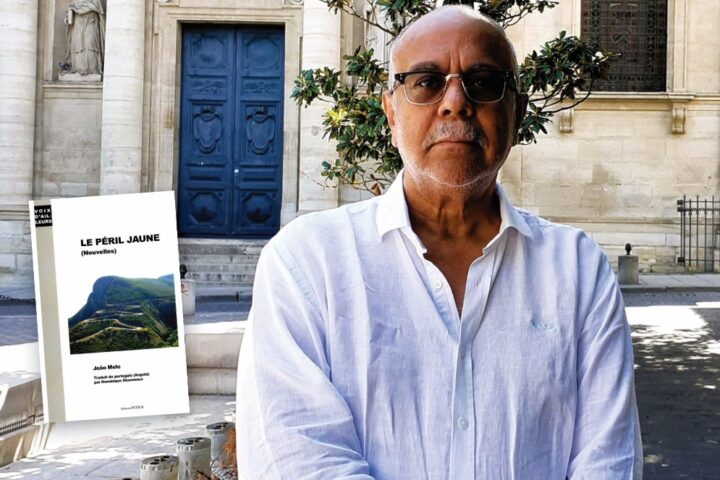«La photo déchirée», un film de José Vieira. Un film témoin, un film pour l’histoire de l’émigration portugaise.
«La photo déchirée», un film documentaire entre souvenirs d’enfance et témoignages d’immigrés portugais retraités rentrés au Portugal. Le réalisateur s’appuie, par ailleurs, d’images d’archives pour dresser une chronique de l’émigration clandestine portugaise.
Un travail utile et nécessaire.
Après un premier débat organisé en janvier 2018 à partir du film «Les émigrés» du même José Vieira, la CGT de Tourcoing a prolongé la réflexion ce vendredi 25 janvier avec la projection d’un deuxième film du même auteur: «La photo déchirée» en présence de l’auteur.
José Vieira a présenté son film comme étant son premier d’une liste qui est en train de s’allonger, ça démarche étant d’enregistrer des témoignages, de laisser une trace d’une période de l’immigration portugaise rarement abordée par les médias.
En 2001 José Vieira prend son baston de pèlerin à la recherche d’histoires qui alimenteront l’histoire de l’émigration, de l’immigration portugaise depuis les années 1960.
José Vieira, un acteur-témoin, un chercheur, un graveur, lui qui est arrivé en France tout jeune, en 1965.
La question posée par son film est du pourquoi partir?
«La photo déchirée»: c’est une image, un acte qui a laissé des souvenirs à ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés… l’image de la séparation. La photo, quoique déchirée, se reconstituera le plus souvent: signe d’y être arrivé… et plus tard, symbole des retrouvailles, de la reconstitution de la famille.
Avant que le passeur prenne en charge le candidat à l’exil, la photo de celui-ci est déchirée en deux, l’épouse en gardera une moitié. Le voyage se terminant, l’exilé donne au passeur l’autre moitié. De retour au Portugal, le passeur montre la moitié de la photo à l’épouse… autorisation pour le paiement de la soulte au passeur pour l’accomplissement de sa besogne.
92% des Portugais partis l’ont fait de manière clandestine. Sortir du Portugal, pays recordman de la plus longue dictature d’Europe, était considéré une évasion, un crime, des traites qui fuyaient la misère, qui fuyaient le prophète Salazar.
À l’époque, la France sortait de la décolonisation, le Portugal s’enfonçait dans la guerre coloniale, imposant au pays d’énormes sacrifices financiers et humains. Pour le jeune adulte, tout juste sortie de l’adolescence, deux voies s’ouvraient: la guerre coloniale ou l’exil.
Après des jours et des jours de voyage – le jour se confondant parfois avec la nuit – les Portugais arrivent par milliers en France… ils s’entassent dans des baraques… des bâtisseurs qui sont venu pour aider à reconstruction de la France. On appellera ces années-là… «Les trente glorieuses».
Entre 1960-1970, 1,4 millions de Portugais partent, ils seront protagonistes de conditions inhumaines… on les entasse dans des camions, on leur fait traverser des montagnes à pied, ils auront faim et surtout soif… des conditions qu’on ne fait même pas subir à des animaux. Beaucoup sentiront, diront: «la peur nous a accompagnés jusqu’à notre destin».
Pour s’acquitter de toute cette souffrance, il a fallut débourser pour payer le passeur de 6 à 9 mois de salaire.
Combien sont-ils restés en chemin? Personne ne le sait, même si nombreux sont les témoignages pour dire que les passeurs abandonnaient les plus faibles, les malades, les moins résistants… une nécessité pour sauver, mener à bon port, la majorité?
On a dormi avec des moutons, des vaches… Des souvenirs… ils l’ont fait… c’est du passé… c’est loin?
Soixante ans après, la majorité, une minorité (?) dira avoir été bien accueillie… Veut-on oublier, a-t-on besoin d’oublier? Allez vivre dans des barraques, ne pas avoir un vrai accueil était-ce le rêve du portugais qui partait?
Après une année, des années d’exil, on revient au pays, on fait travailler ceux qui sont restés, des maisons se construisent, on ne parle pas des conditions de vie vécues en France… il faut donner la preuve qu’on a bien fait de partir.
Chaque émigré portugais a son histoire. Histoires qui, au fond, se rejoignent.
Il y a l’histoire de celui qui donne une adresse à un taxi, le taxi cherche, cherche et finit par abandonner. Le nouvel immigré trouve un banc sur un jardin, il y dort. Le lendemain, un compatriote lui montre le chemin… la barraque.
Il y a un autre témoin qui dit avoir une fois travaillé 33 heures de suite dans un chantier… le prix à payer pour que le patron décide de lui faire les papiers pour pouvoir rester en France.
Le dimanche on se réunit, on partage… la cravate, le nœud papillon des jeunes garçons… une façon de garder, de montrer sa dignité, même si les bidonvilles de la région parisienne étaient peuplés de portugais, peuplés de…
La sortie du bidonville, pour beaucoup, comme la sortie de la clandestinité.
Quelques dizaines d’années après, on entend encore, l’émigré, l’immigré portugais dire: «je suis étranger en France… je suis étranger au Portugal».
Voilà, c’est de tout cela que le film de José Vieira nous parle, et bien plus.
Dans le public présent, après la projection, quelques personnes avaient les larmes aux yeux. Ils ont retrouvé dans le film leur histoire… un bout de leur vie.
Un gardien professionnel de Guimarães racontera son expérience, son «salto», lui qui n’avait pas vraiment besoin d’émigrer… il gagnait 15 fois le SMIC.
Très touchante l’histoire d’une dame qui raconte, que le premier cadeau que sa sœur a reçu en France, a été un miroir… une manière de dire: «regarde-toi dans le miroir, n’aies pas honte». Ce témoin avouera: «J’aime la France, j’aime le Portugal, j’ai besoin de la France, j’ai besoin du Portugal».
Une dame dans le public raconte ce qu’elle a vu à Calais, à Sangatte… outrée, elle dit ne pas comprendre le drame de ses hommes, femmes, enfants venus d’ailleurs. Nous dirons… «et pourtant les films de José Vieira sont là pour témoigner… l’histoire se répète… un drame décuplé… l’homme a souvent la mémoire courte».
Le réalisateur José Vieira conclura en affirmant: «les gens partent encore aujourd’hui pour la même raison». Il répond à une question par: «l’explication de la misère d’aujourd’hui comme d’hier est essentiellement politique».
[pro_ad_display_adzone id=”20983″]