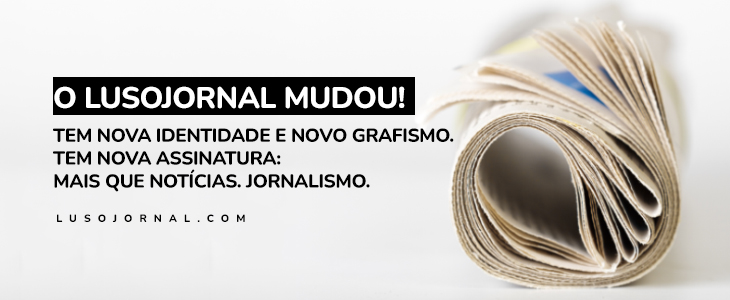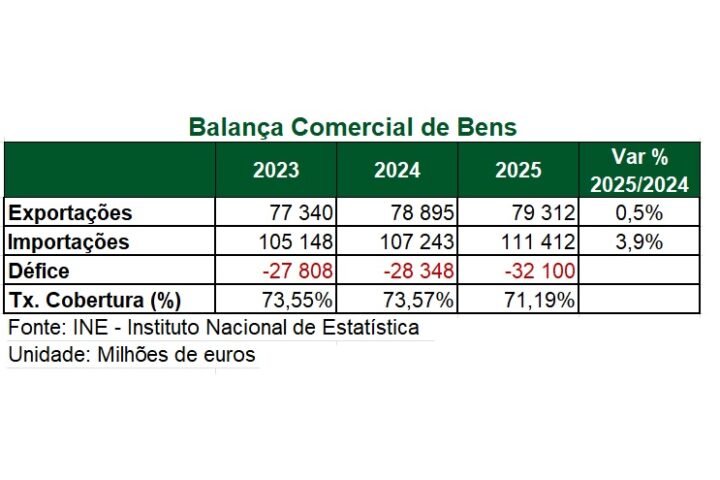[pro_ad_display_adzone id=”46664″]
Un documentaire sur un lien familial entre le Brésil et l’Algérie et un travail de traduction qui, à travers le cinéma, relie deux langues, le portugais et le français. Le documentaire – présent cette année au Festival de Cannes – a été réalisé par l’artiste cearense d’origine algérienne Karim Aïnouz et la traduction – cette langue du monde qui passe si souvent inaperçue, alors qu’elle permet aux spectateurs d’accéder à une œuvre d’art jusque-là inaccessible – est de Clara Domingues, traductrice française d’origine portugaise.
Karim Aïnouz est né à Fortaleza, d’une mère brésilienne, chercheuse experte en algues rouges, et d’un père kabyle, ingénieur. Ses parents se rencontrent dans les années 1960, aux États-Unis, alors qu’ils sont encore étudiants, et Karim verra le jour en 1966. Enfant, il ne connaît de son père que les cartes postales que celui-ci lui envoie depuis l’autre côté de l’océan où il est parti s’atteler à la construction d’une Algérie indépendante. Karim grandit dans la promesse de ce père qui devait venir les chercher, lui et sa mère, pour qu’ils partent vivre ensemble en Kabylie. Il attendra en vain, jusqu’à s’en désintéresser. L’image de son père se perd entre Paris et Alger, Karim ne le rencontrera qu’à l’âge de 18 ans, en France.
Il attendra encore 36 ans pour aller à la découverte du village familial, un lieu perdu dans les montagnes de l’Atlas et devenu presque mythique pour ce fils qui ignore tout de sa famille paternelle.
De ce voyage naîtra un documentaire dont le titre mystérieux et paradoxal – «Marin des Montagnes» – nous prépare déjà à la suite: un film, comme nous dit Clara Domingues, qui «raconte surtout les résistances et l’énergie de deux peuples dans leur lutte pour la liberté». Deux peuples, le brésilien et l’algérien, qui ont lutté contre deux types d’oppression très similaires. Les Algériens ont combattu un colonialisme français anachronique et sanglant tandis que les Brésiliens ont affronté vingt ans d’une dictature militaire d’extrême droite.
C’est à travers les yeux et la sensibilité de la traductrice Clara Domingues qu’on découvre, d’une part, ce film aussi magique que poétique et, d’autre part, les difficultés d’un métier, la traduction, l’une des principales armes contre l’intolérance et la haine, en ce qu’elle nous donne accès à la connaissance et à la découverte d’autres cultures, car, on le sait bien, l’ignorance est le principal carburant de la haine.
Clara, qu’est-ce qui t’a le plus impressionné dans ce documentaire? Les deux pays ont connu des moments difficiles, la lutte pour l’indépendance en Algérie et la dictature militaire au Brésil…
Karim Aïnouz raconte surtout les résistances et l’énergie de deux peuples dans leur lutte pour la liberté. Quel que soit le pays, le désir d’émancipation est très beau et inspire le respect. Mais ce qui m’a le plus touchée, c’est l’amour que le réalisateur porte à sa mère. Il fait ce voyage en Kabylie alors qu’elle est déjà décédée, pourtant elle est présente à chaque instant du film. Et cette présence n’a rien de morbide, elle est pleine de vie et de tendresse. Par la seule force de ses sentiments (et de son talent), le réalisateur crée l’illusion d’un temps suspendu, un temps où sa mère est là.
Tu viens de faire tes débuts au Festival de Cannes en tant que traductrice de ce documentaire. Qu’est-ce qui t’a semblé le plus difficile dans ce travail? Et qu’est-ce qui t’a plu?
Lorsque le film a été sélectionné pour Cannes, une course contre la montre s’est enclenchée. Le délai pour rendre le sous-titrage était court. Il a fallu faire vite, et bien. Derrière les images que l’on voit au cinéma, il y a des années de création, de travail et d’attente, il y a aussi une forte implication émotionnelle, en particulier dans un film autobiographique comme Marin des montagnes. Un sous-titrage bâclé par manque de temps peut fragiliser la réception d’un film. L’enjeu étant important et le Festival de Cannes n’attendant pas, il ne restait qu’une solution: distordre le temps, l’étirer au maximum, tout en faisant comme s’il n’existait pas. Un vrai tour de passe-passe! Le plus grand plaisir quand je traduis, que ce soit pour l’édition ou le cinéma, c’est d’avoir le sentiment d’être face à un auteur. Quelqu’un qui a pensé et travaillé son œuvre en profondeur. C’est à la fois intimidant et en même temps très stimulant. Avec Marin des montagnes, cette magie a opéré.
Pour une traductrice de l’audiovisuel, voir son texte être présenté à Cannes est une étape importante, n’est-ce pas?
C’est une grande joie, sans le moindre doute. Mais depuis que je suis traductrice, j’ai appris à ne pas réfléchir ainsi, à ne pas considérer telle traduction ou tel événement comme une étape après laquelle tout serait plus simple, par exemple. La traduction est une activité fragile. Elle repose, encore et toujours, sur la confiance qu’un réalisateur, un producteur, un laboratoire de sous-titrage, ou un éditeur s’agissant de la littérature, veut bien nous accorder. Cette confiance n’est pas acquise à tout jamais, elle se nourrit à la fois d’éléments objectifs et d’autres qui le sont moins. Bref, je me réjouis du moment présent, sans le considérer comme une étape, mais plutôt comme un événement exceptionnel qui se reproduira peut-être, ou peut-être pas.
Clara, les spectateurs qui vont au cinéma et passent par les sous-titres pour accéder à une langue qu’ils ne connaissent pas, pensent rarement que quelqu’un a passé des jours et des jours à traduire tous ces mots. Il y a peut-être même des gens qui pensent que tout a été traduit par une intelligence artificielle quelconque. Aujourd’hui, en littérature, malgré tout, on donne plus de visibilité aux traducteurs, dont le nom figure parfois sur la couverture à côté de celui de l’auteur. Que faut-il faire pour qu’il en soit de même au cinéma?
La traduction audiovisuelle partage des traits avec la traduction littéraire, tout en étant différente. La différence fondamentale réside, selon moi, dans la coexistence indépassable, au cinéma, de la traduction avec la VO, alors que, pour la littérature, l’œuvre originale et l’œuvre traduite vivent leur vie indépendamment. De plus, pour être réussi, un sous-titrage doit parvenir à se faire oublier. Ni trop long, ni trop rapide, simple à lire tout en respectant le ton et le style de l’auteur, un sous-titre doit pouvoir être lu à l’insu du spectateur pour ne pas gâcher la rencontre avec le film. Dans ces conditions, il n’est guère étonnant que la reconnaissance des traducteurs de l’audiovisuel diffère de celle des traducteurs littéraires. En particulier auprès du grand public. Si les lecteurs avisés connaissent le nom de leurs traducteurs préférés, je n’ai jamais entendu un cinéphile citer le nom d’un traducteur. En revanche, la règle veut que chaque sous-titrage soit signé, et les traducteurs figurent parfois au générique, comme c’est le cas dans Marins des montagnes. Les journalistes et les critiques de cinéma sont à la bonne place pour éveiller l’intérêt du public aux enjeux du sous-titrage, il leur suffirait de s’intéresser à la traduction de la même manière qu’ils s’intéressent à la musique ou à la lumière d’un film.
[pro_ad_display_adzone id=”37509″]