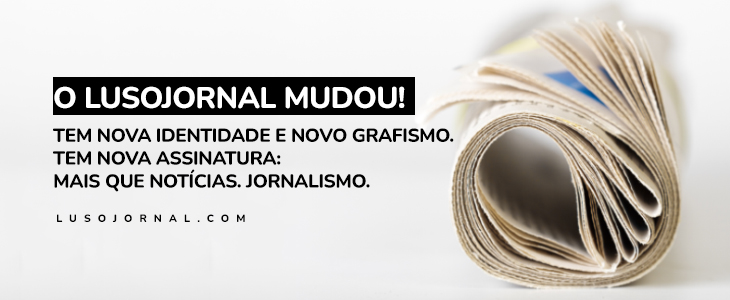
Cela fait, demain, exactement 116 ans. Le 29 mars 1809, la ville de Porto a vécu la journée la plus dramatique de son histoire, lors de la deuxième Invasion française (du 03 février 1809 au 12 mai 1809), par les troupes de Napoléon, à la tête desquelles on trouvait le Maréchal Soult.
Les troupes de Napoléon rentrent par le nord du Portugal, traversent Chaves, le 12 mars, Ruivães et Braga. Le 20 mars, elles quittent Braga, direction Porto, où le dramatique accident du pont va avoir lieu.
Qui, d’entre nous, s’est aperçu de l’évocation de ce drame lors d’une visite à Porto ? Et pourtant, tout touriste en visite à Porto passe juste à côté.
Un bas-relief l’évoque, sur le mur de la maison «Casa da Ribeira», presque au pied du Pont D. Luis, côté Porto, rua Cais da Ribeira, quartier Patrimoine Mondial de l’UNESCO, deux éléments en acier, l’un coté Porto, l’autre côté Vila Nova de Gaia. Il est vrai qu’à ces endroits bien d’autres choses attirent l’œil du visiteur : la beauté du Pont, les acrobates, les chanteurs de rue, les automates, les hélicoptères qui descendent et remontent le Douro, tout cela dans un fleuve de touristes.
Le 29 mars 1809, les troupes du Maréchal Soult arrivent à Porto provoquant la fuite d’une bonne partie de ses habitants. Après trois jours, ne restent à Porto que ceux qui n’ont pu réussi à s’échapper.
La ville de Porto subira l’assaut des soldats pilleurs des troupes de Napoléon pendant plusieurs jours.
Porto – à l’époque peuplé d’environ 40 mille habitants – va voir disparaître en une journée 4 mille, soit 10% d’entre eux.
La peur des troupes françaises qui entrent dans Porto de manière inattendue, poussent des milliers de ses habitants vers le fleuve Douro. La population effrayée tente de traverser le fleuve vers l’autre rive afin de prendre une certaine distance par rapport aux envahisseurs en empruntant un pont construit par 20 barques reliées entre elles, qui permettaient de passer d’une rive à l’autre. Sous le poids de la foule, le pont cède et environ quatre mille personnes se noient.
Citer des chiffres c’est toujours délicat. Selon certains historiens, aux 4 mille morts de la Ponte das Barcas, il faut encore ajouter entre 9 à 10 mille pertes côté troupes portugais et 12 mille du côté français, à quoi il faut ajouter 20 mille blessés.
À la mémoire des 4 mille noyés, un bas-relief en bronze portant le nom d’«Alminhas da Ponte» a donc été placé sur le mur d’édifice situé actuellement pas loin du bas du Pont D. Luis. Ce bas-relief exécuté en 1897 représente la tragédie et est lieu de croyance par les gens de la Ribeira, des cierges y sont déposés brûlant en continu.
Le bas-relief a été conçu par le sculpteur José Joaquim Teixeira Lopes, père de l’architecte José Teixeira Lopes et du sculpteur António Teixeira Lopes. Tous les trois sont passés par les Beaux-Arts à Paris. On sait que le fils, José, est entré en franc-maçonnerie en 1898, dans la loge Ave Labor, sous le nom symbolique Blondel, probablement conseillé par son père, le concepteur du symbolique bas-relief.
Coïncidence ? Le fils du sculpteur, lui-même sculpteur, António Teixeira Lopes, né à Vila Nova de Gaia, sera le sculpteur du monument Portugais de La Couture, inauguré le 10 novembre 1928 en honneur des soldats du Corps Expéditionnaire Portugais (CEP) qui ont participé à la I Guerre mondiale.
Deux siècles après le drame de la Ponte das Barcas, le Président de la République Portugaise, Cavaco Silva, a inauguré le 29 mars 2009 un monument en deux parties, chacune de son côté du rivage, côté Porto et côté Vila Nova de Gaia, représentés par deux barres d’acier placées sur les murs mêmes où étaient amarrées, avec des cordages, les barques, le matin du 29 mars 1809.
Les deux barres métalliques, plutôt visibles du fleuve même, sont l’œuvre de l’architecte, né à Porto, Souto Moura, concepteur également du Stade municipal de Braga.
Une idée pour une prochaine visite à la capitale du nord du Portugal ? Pourquoi pas aller à la découverte des œuvres et avoir une pensée pour les disparus.
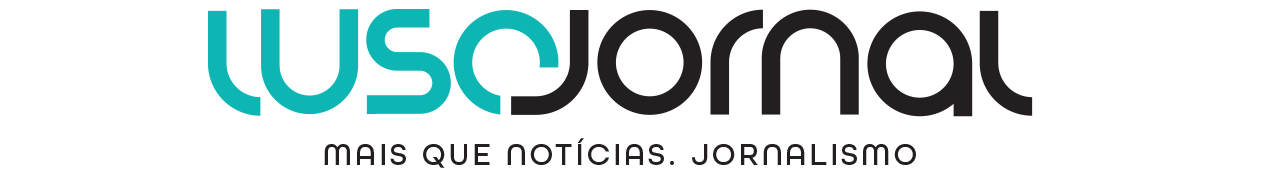












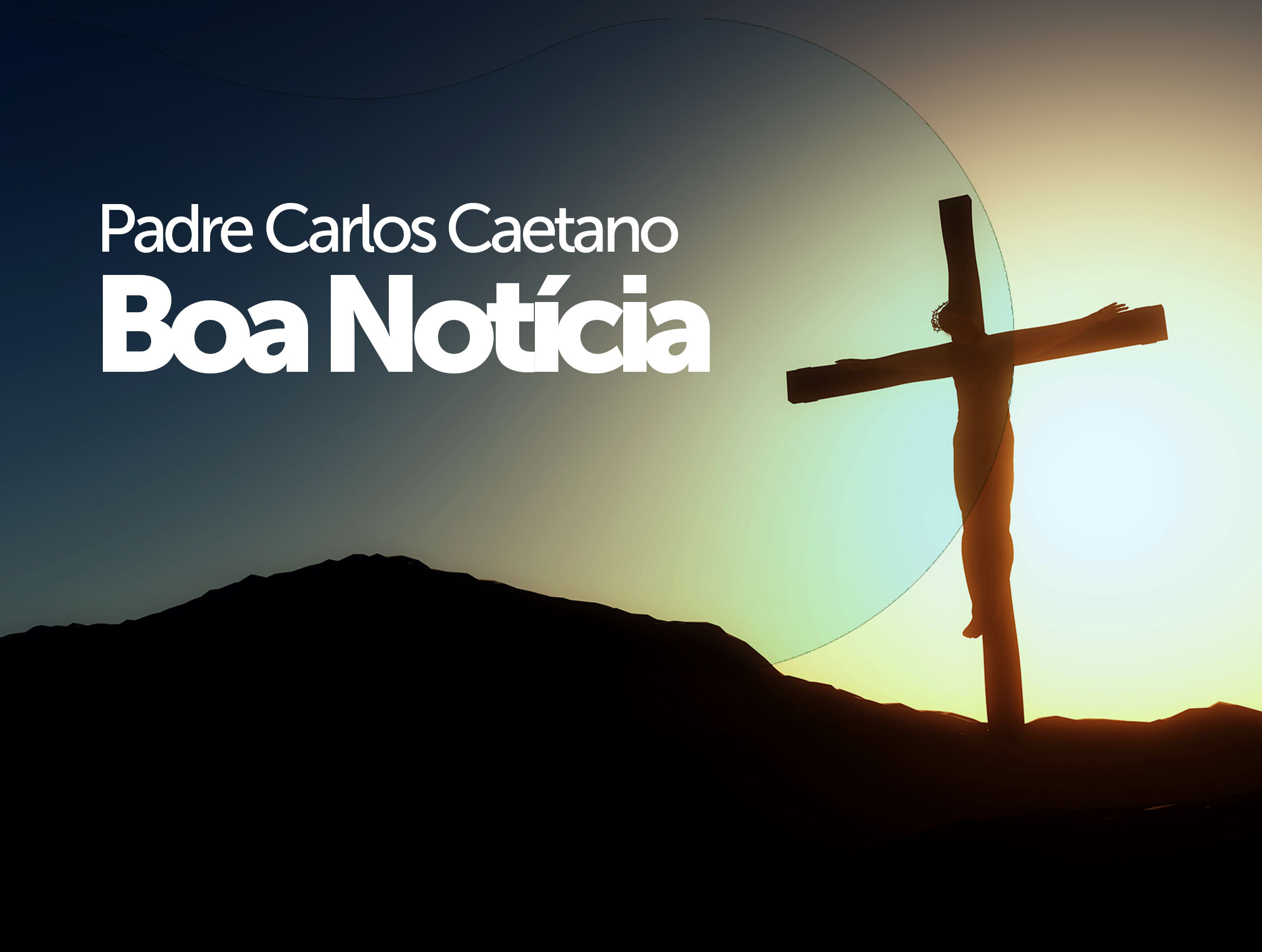


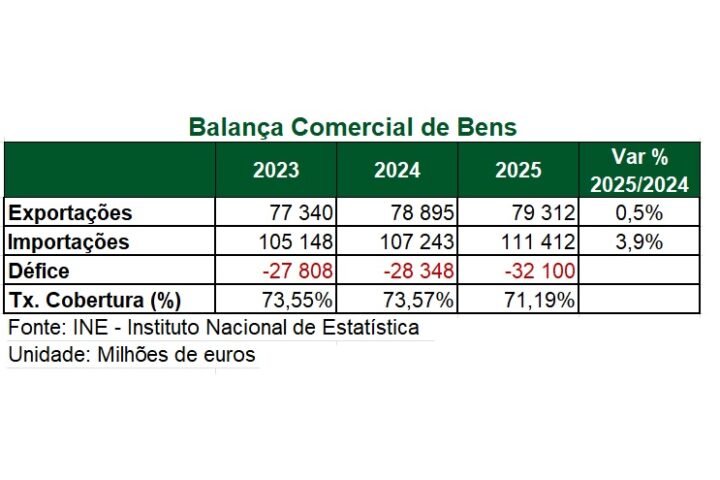



DOIS LIVROS – PARA SABER MAIS
TROISIEME INVASION DE BAPOLEON AU PORTUGAL
Les rares études historiques réalisées en France sur les invasions françaises au Portugal sont très évasives et sont souvent confondues avec la guerre de l’Espagne contre Napoléon, comme si le Portugal n’avait pas existé. Le Portugal a vécu en Paix avec la France après le traité de Madrid le 29 septembre 1801. Le 21 novembre 1806, Napoléon décréta le blocus continental. Napoléon envoie un ultimatum au Palais Royal du Portugal pour fermer ses ports à l’Angleterre. Le 20 octobre 1807, Napoléon déclare la guerre au Portugal.
Le Portugal connaît trois invasions : 1807, 1808 et 1810
Os raros estudos históricos feitos em França sobre as invasões francesas em Portugal, são muitas evasivos, sendo frequentemente confundidos com a guerra de Espanha contra Napoleão, como se Portugal não tivesse existido. Portugal viveu em Paz com a França depois do tratado de Madrid em 29 de setembro de 1801. Em 21 de novembro de 1806, Napoleão decretou o Blocus Continental. Napoleão envia um ultimato ao Paço Real de Portugal, para fechar os seus portos à Inglaterra. Em 20 de outubro de 1807, Napoleão declara a guerra a Portugal.
Portugal conhece três invasões : 1807, 1808 e 1810.
CRONOLOGIE DE NAPOLEON
Hier comme aujourd’hui, on se dispute toujours pour savoir qui il était, ou pour dire qui était Napoléon. Certains disent qu’il était un tyran, un dictateur qui a mis l’Europe à feu et à sang. D’autres disent qu’il était le sauveur, le précurseur de nos États et de nos sociétés modernes, ou encore qu’il fît les guerres pour le seul et unique but de servir sa gloire… Ce travail a été compilé de bonne foi par l’auteur qui s’est abstenu de tout jugement préétabli. Dans cet ouvrage figurent tous ceux qui ont joué un rôle important et moins important, dirais-je même, parfois essentiel dans la vie de Napoléon.
Ontem como hoje, discutimos sempre sobre quem ele era, ou sobre quem era Napoleão. Há quem diga que ele era um tirano, um ditador que incendiou a Europa. Outros dizem que ele era o salvador, o precursor dos nossos Estados e das nossas sociedades modernas, ou ainda que fazia as guerras pelo único objectivo de servir a sua glória… Este trabalho foi compilado de boa fé pelo autor, que se absteve de qualquer julgamento pré-estabelecido. Neste livro figuram todos aqueles que desempenharam um papel importante e menos importante, diria mesmo, por vezes essencial na vida de Napoleão.